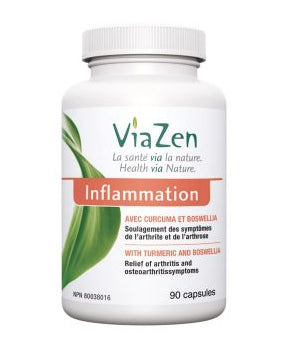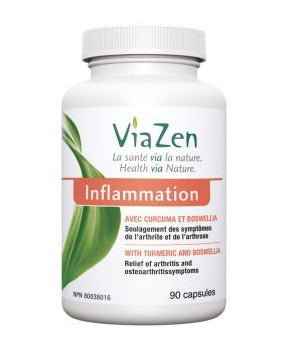Qu’est-ce que l’inflammation ?
L’inflammation résulte d’un processus réactionnel de l’organisme face à un agent agresseur. L’agent responsable de l’inflammation peut être d’origine infectieuse (une bactérie ou un virus), chimique (contact avec des substances toxiques), causé par un déséquilibre immunitaire (allergies, antigènes cellulaires étrangers (greffes tissulaires), antigènes devenus étrangers (processus auto-immun) ou découler d’un traumatisme physique (radiations, frottements).
L’inflammation se manifeste par un ensemble de signes cliniques bien spécifiques incluant la rougeur, la chaleur, l’enflure, la douleur et, dépendamment de l’ampleur de l’inflammation, de la fièvre, une augmentation de la fréquence cardiaque et un malaise général. Aussi, on observera inévitablement une altération du fonctionnement de l’organe touché. Citons à titre d’exemple, la difficulté à bouger dans le cas d’une inflammation articulaire.
L’inflammation sera aiguë et de courte durée si l’agent agresseur est rapidement contrôlé ou supprimé, permettant la guérison des tissus affectés. L’inflammation deviendra chronique et perdurera tant et aussi longtemps que le facteur d’agression demeurera présent.
Que se passe-t-il exactement ?
La structure affectée réagit d’abord au contact de l’agresseur. La réaction inflammatoire comporte une suite d’événements physiologiques et métaboliques complexes, modulés et orchestrés par des médiateurs de l’inflammation (histamine, prostaglandines, cytokines, etc.). Ces médiateurs proviennent des cellules ou du plasma.
La rougeur est occasionnée par la dilatation des vaisseaux et l’augmentation du débit sanguin dans la région affectée. Une chaleur en résulte. La libération de liquide (exsudat inflammatoire) dans l’espace intercellulaire engendrera la tuméfaction (enflure). La douleur qui apparaît est une conséquence de la compression des terminaisons nerveuses par la tuméfaction et par l’action de facteurs chimiques libérés dans la région atteinte.
Enfin, un malaise général se traduisant par de la fatigue et une légère déprime, voire même la sensation d’être « mal dans sa peau » apparaît en raison de la demande énergétique importante lors du processus inflammatoire.
Le terme arthrite est le terme générique pour désigner plus d’une centaine d’affections inflammatoires des articulations, qu’elles soient aiguës ou chroniques. La plupart des formes d’arthrite sont chroniques, c’est-à-dire qu’elles s’installent sur plusieurs mois ou plusieurs années, et rendent la vie invalidante.
Les articulations touchées, le degré de la douleur et des ankyloses varient d’un individu à l’autre et selon le type de maladie articulaire. L’inflammation apparaît au niveau d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des structures qui composent l’articulation (la capsule articulaire, la membrane synoviale, le cartilage, les ligaments et les tendons).
Manifestations cliniques de l’inflammation articulaire
L’inflammation peut être présente au niveau d’une seule ou de plusieurs articulations simultanément. Toutes les articulations du système musculo-squelettique peuvent être touchées par l’arthrite. Elle affecte les hanches, les genoux, les chevilles, les pieds, les doigts, les poignets, les coudes, les épaules et la colonne vertébrale. Voici quelques manifestations cliniques courantes :
- La peau peut être rouge et chaude
- L’enflure : l’articulation est augmentée de volume
- Une sensibilité de l’articulation au toucher
- Les douleurs articulaires qui peuvent apparaître de manière brutale et qui sont habituellement très intenses
- La raideur articulaire nommée également ankylose
- De petites bosses ou nodules, surtout sur les doigts et les orteils
- La déformation des articulations
- La fatigue peut être présente
- La fièvre
- Un malaise général (sensation d’être « mal dans sa peau »)
L’intensité des symptômes varie selon la pathologie arthritique. Elle peut aussi varier d’une personne à l’autre. Certaines personnes connaissent des périodes de rémission, pendant lesquelles les symptômes s’atténuent, et peuvent même disparaître complètement.
À long terme, la surproduction d’inflammation aura des conséquences néfastes sur la santé articulaire, puisqu’elle engendrera une perte de la mobilité articulaire.